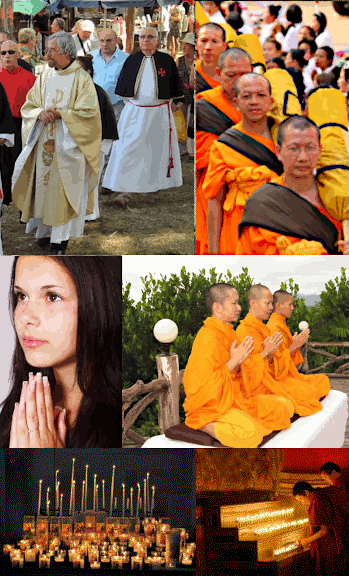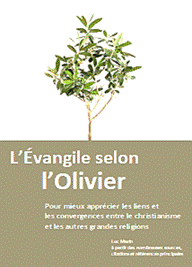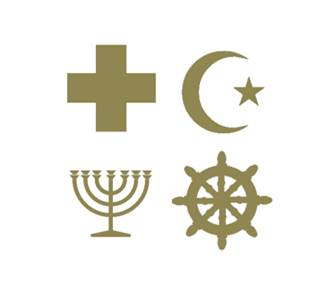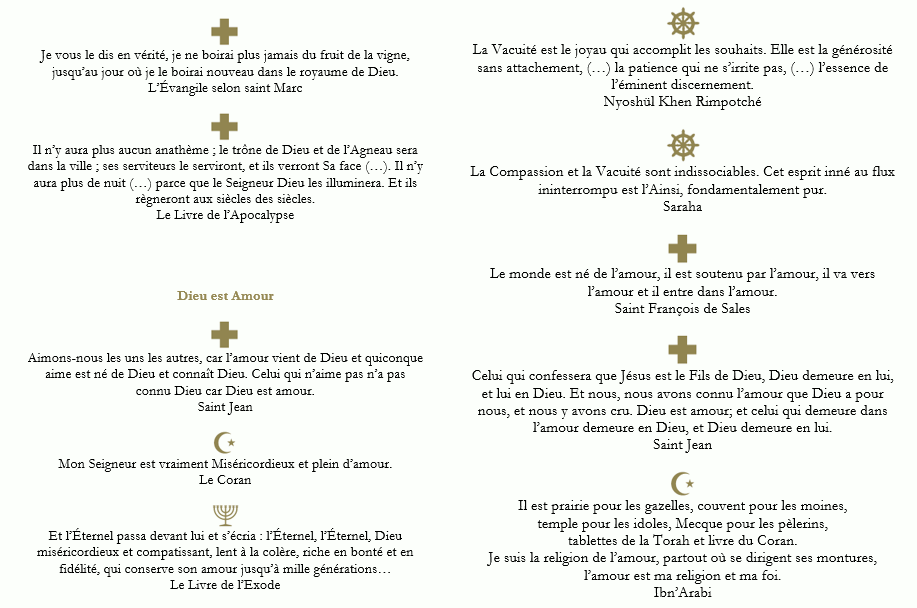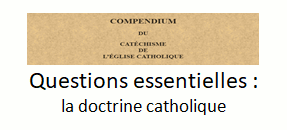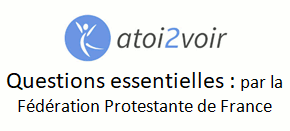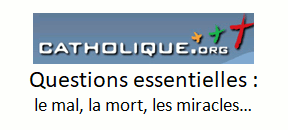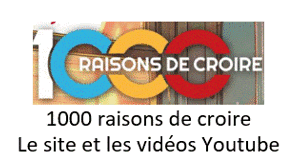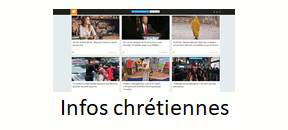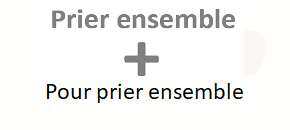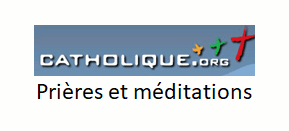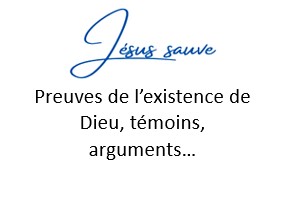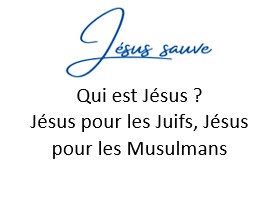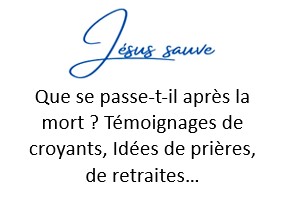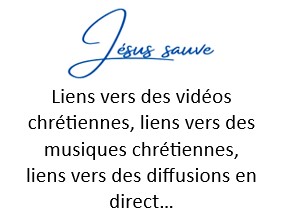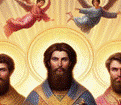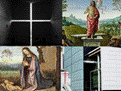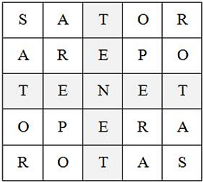|
Méditation
chrétienne et bouddhiste méditer en ligne
ou « en livre » |

|
La
méditation dans le christianisme et dans le bouddhisme :
en savoir plus |
|||
|
La pratique de la méditation est
inscrite dans le bouddhisme depuis sans doute ses débuts. Celui-ci partage
d’ailleurs des pratiques très comparables avec le jaïnisme et avec
l’hindouisme dont il est issu ; elles ont permis « l’éveil »
du Bouddha qui, selon la légende, a décidé de s’installer sous un arbre sans
rien faire d’autre que méditer pour atteindre la Vérité. Dès lors la méditation fait
partie du quotidien de ces religions orientales, et plus encore dans la
pratique du bouddhisme zen où elle est centrale. On attribue même cette phrase au Bouddha : « Il n’y a pas de
méditation sans sagesse. Il n’y a pas de sagesse sans méditation ». D’ordinaire on a peu conscience de la place de la méditation dans le
christianisme également, et là aussi sans doute dès ses débuts. Il n’est pas
exclu qu’il y ait même eu d’authentiques liens avec l’hindouisme et avec le
bouddhisme : les influences des religions orientales ont pénétré tout le
Proche-Orient du fait d’échanges qui ont peut-être toujours existé, et plus
encore après l’épopée d’Alexandre le Grand jusqu’en Inde. On comprend
alors pourquoi la carte d’Ératosthène montre une bonne connaissance de l’Inde
de la part du monde occidental. Inversement, au IIIème
siècle avant notre ère, l’empereur indien Akosha entreprend de diffuser le
bouddhisme dans son pays mais aussi dans l’ensemble de l’Asie et jusqu’aux
« terres des Grecs ». Au Ier siècle avant notre ère
les Ptolémées d’Égypte et les Romains échangent avec l’Inde par la voie
terrestre de l’Asie Mineure puis par la route maritime des moussons, sur
laquelle étaient transportés de nombreux biens (ivoire, épices, esclaves…),
comme le rapporte l’ouvrage « Le Périple de la mer Érythrée ». On
comprend alors pourquoi la carte d’Ératosthène montre une bonne connaissance
de l’Inde de la part du monde occidental, et pourquoi on ne compte plus les
témoignages sur les « gymnosophistes » indiens pendant toute
l’Antiquité. Il est donc certain que les idées, aussi, ont voyagé. C’est ainsi qu’un
ascète indien aurait fini ses jours en Grèce d’après le témoignage de son
contemporain, le célèbre historien Strabon ; il aurait été un membre de
la délégation d’un roi indien dont parle Pline, et avec lequel on commerçait
dans toute la Méditerranée. Les échanges sur la philosophie orientale
paraissent d’autant plus plausibles quand on pense que c’est une ambassade de
ce même monarque qui a été reçue par l’historien et philosophe Nicolas
de Damas, secrétaire d’Hérode le Grand, le roi de Judée lors de la
naissance de Jésus. Peu de temps après le grand philosophe juif, Philon
d’Alexandrie, loue les gymnosophistes indiens qui « transforment leur
conduite tout entière en une démonstration de vertu ». Difficile alors de ne
pas remarquer combien les « nazirs » dans le judaïsme du temps de
Jésus ressemblent aux « sadhous » qu’on rencontre en Inde, combien
les ermites et les prophètes itinérants du Proche-Orient ressemblent
respectivement aux « vanaprasthas » et aux « shramanas »
de l’Inde antique, et combien les « esséniens » et les
« thérapeutes », admirés notamment par l’historien Flavius Josèphe
en Judée et à Alexandrie, semblent avoir reçu eux aussi des traditions
provenant du bouddhisme et de l’Orient : pratiques liant foi, pureté et
guérison, parfois végétarisme, et sinon bains rituels,
méditation et prière. Les
« nazaréens », groupe dont est issu Jésus, ont sans doute puisé aux
mêmes sources que les nazirs et les esséniens, qui se retiraient
dans les campagnes ou dans des lieux arides comme Qumran, près des
rives de la Mer Morte, pour méditer les textes saints. Les « nazaréens », groupe dont sont issus Jean-Baptiste et
Jésus, ont sans doute puisé aux mêmes sources que les nazirs
et les esséniens, qui se retiraient dans les campagnes ou dans des
lieux arides comme Qumran, près des rives de la Mer Morte, pour méditer les
textes saints. À cette lumière on comprend alors peut-être d’autant mieux l’importance
des jours passés par Jésus dans le désert, la veillée de prière sur
le Mont des Oliviers, les méditations ou les communautés établies
dans des grottes aux premiers temps du christianisme, et même le voyage
jusqu’en Inde attribué à saint Thomas...
Ces racines du judaïsme et du christianisme ont également beaucoup à
voir avec l’islam, Mahomet recevant dans une grotte du mont Hira la révélation
de la part de l’ange Gabriel, une des nombreuses figures partagées par toutes
les religions abrahamiques. La méditation sera aussi la pratique des
ermites et des moines, qui se retirent du monde dans le désert ou dans la
cellule de leur monastère ou même encore dans des grottes,
au Proche-Orient, en Égypte, en Éthiopie et en Europe : ainsi
saint Antoine et, pourtant bien longtemps après, saint François d’Assise…
Ce sera encore la pratique des mystiques chrétiens et soufis, et plus
généralement de tous les Juifs, Chrétiens et Musulmans, quand ils prient en recherchant
le plus grand recueillement. Autant de points communs entre
les « religions du Livre », et entre celles-ci
et les religions orientales.
Au-delà de ces ressemblances apparemment superficielles, tandis que des
différences bien sûr subsistent, on a peu conscience également des
points communs essentiels que liste ce même ouvrage.
Des chrétiens célèbres y sont aussi cités, comme Thomas Merton ou Sundar
Singh, sadhou indien converti, qui ont déployé des trésors de spiritualité
rapprochant encore davantage certains aspects du bouddhisme et du
christianisme. Et l’on a peu conscience du fait que la méditation est
certainement l’un de ces points communs essentiels. « L’évangile
selon l’Olivier » le montre encore en évoquant les noms du
christianisme qui en ont fait l’éloge, mais souligne aussi le fait que la
méditation est une des pratiques chrétiennes au même titre que dans d’autres
religions. Elle est même explicitement citée dans le catéchisme officiel de
l’Église Catholique : « la tradition chrétienne a retenu trois
expressions majeures de la vie de prière : la prière vocale, la
méditation, l’oraison. Un trait fondamental leur est commun : le
recueillement du cœur ». Elle est pratiquée depuis les origines du
christianisme, par les moines et pas seulement, comme on l’a déjà noté plus
haut. Elle se manifeste notamment par le « silencieux amour »
évoqué par saint Jean de la Croix au XVIème siècle. Elle peut en fait se
décliner en oraisons de différents niveaux, depuis l’oraison vocale jusqu’à
une oraison silencieuse menant à l’union mystique avec Dieu, ainsi que
l’expose sainte Thérèse d’Avila (« Le Château intérieur »).
Elle peut se pratiquer en suivant les « exercices spirituels »
recommandés par saint Ignace de Loyola à la même époque. Elle peut aussi
s’appuyer sur une lecture, un verset des Textes Saints comme le suggère Jean
Cassien au IVème siècle (qui disait s’inspirer d’une pratique
provenant des premiers moines et apôtres), ou sur la récitation du rosaire
chez les catholiques (éventuellement avec l’aide d’un chapelet, ce qui nous
rapproche beaucoup à nouveau de pratiques bouddhistes puis musulmanes). À sa
place l’on peut également répéter le simple mot « Maranatha »
(de l’araméen signifiant « Viens, Seigneur », expression présente
dès les premiers textes chrétiens), comme le propose le bénédictin John Main
au XXème siècle (et donc comme un « mantra »
bouddhique), ou bien encore le seul nom de Jésus comme le font les moines
orthodoxes qui pratiquent « l’hésychasme » ou « prière du
cœur » en s’appuyant sur le rythme de la respiration (cette pratique
présentant elle aussi bien des ressemblances avec certaines techniques
orientales). L’oraison silencieuse et la méditation
sont, on le voit, très présentes dans le monde chrétien. Saint François
de Sales a même dit avec humour : « Une demi-heure de
méditation est essentielle sauf quand on est très occupé. Alors une heure est
nécessaire ». Logiquement des
livres, des sites internet, proposent des méthodes qui s’appuient sur ces
mêmes principes, et montrent combien peuvent être proches les différentes
traditions. La méditation chrétienne est même très naturellement et
directement liée à ce qu’on appelle la « pleine conscience » en ce
qu’elle est, dès les origines, particulièrement ouverte sur ce qui nous
entoure, et en particulier sur les autres : « Le moi
intérieur n'est pas seulement ce qui reste quand nous nous détournons de la
réalité extérieure. Il n'est pas simple vide, ou inconscience » :
« notre moi profond » n’est pas « totalement déconnecté du
monde », comme le notait déjà Thomas Merton entre autres, pour qui
« le partage infini est la loi de vie intérieure de Dieu », que
l’on rejoint en soi par la méditation. À la source, toujours cette même
idée en effet : « C’est dans la mesure même où l’homme pénètre
en soi qu’il pénètre en Dieu et dans la mesure tout autant où il pénètre
en Dieu qu’il parvient à soi. Pour trouver Dieu en réalité, il lui faut
descendre jusqu’en cette profondeur de soi où il n’est plus qu’image
de Dieu ; là même où, au jaillissement de soi, il ne se trouve plus
que Dieu » a écrit le père Henri Le Saux. Ainsi la
méditation permet-elle de trouver Dieu, avec toutes Ses
« Qualités » dont il est question dans ces autres ouvrages
disponibles librement : « L’évangile selon
le monde » et « L’évangile selon
les prophètes et les mystiques ». Ainsi la méditation
permet-elle de Le trouver afin qu’Il S’exprime en nous avec tout ce que cela
signifie de sérénité, de puissance, de richesse et d’amour. La suite dans le livre ci-dessous,
librement téléchargeable. |
|||
|
Méditation
chrétienne et au-delà : texte
et images pour méditer |
|||
|
Plusieurs sites et autant d’ouvrages présentent la méditation
chrétienne, ou donnent des conseils pour commencer ou améliorer sa pratique.
Citons par exemple le site « Notre-Dame
du web ». Voici également un livre, en version numérique gratuite ou en version
papier, reprenant l’introduction ci-dessus et y ajoutant des phrases sous
forme poétique accompagnées de superbes photos, pour se laisser guider dans sa méditation, selon son rythme, quels que
soient les croyants « et même, encore plus généralement, ceux qui ne se
rattachent à aucun courant, à aucune confession ou à aucune église, mais se
reconnaissent dans l’essentiel des grandes idées portées par tous ceux que
nous avons cités, le plus universellement » : Cliquer ici pour accéder au livre au format pdf, gratuit et librement téléchargeable Cliquer ici
pour commander le livre au format papier |
Autres sujets liés :
Les messages des religions
issues de la Bible et même au-delà sont tellement similaires qu’on peine
parfois à les distinguer. Une autre page sur ce site évoque les différences
mais aussi les nombreuses similitudes entre les croyances juives, chrétiennes,
musulmanes et bouddhistes: cliquer ici.
Un livre, « l’évangile
selon l’Olivier », détaille ces questions et met en parallèle,
de cette façon souvent très spectaculaire, les mots principaux de la pensée
chrétienne, juive, musulmane et bouddhiste. L’ouvrage
complet est librement téléchargeable en cliquant sur ce lien.
Extraits de « l’évangile selon
l’Olivier »,
qui met en parallèle les textes du christianisme,
du judaïsme, de l’islam et du bouddhisme
La
méditation est fortement liée à la conscience de soi au milieu des autres et au
cœur de l’univers. Elle encourage donc l’écoute de tout ce qui nous entoure, et
une conscience écologique en relation avec la question religieuse. Un autre
article sur ce site montre combien elles sont associées : cliquer ici.
Illustration extraite du site
« Images et textes pour le quotidien »
La
démarche écologique s’inscrit fort logiquement dans un monde contemporain en
quête de sens et de spiritualité… et dans lequel les possibilités pour aider et
protéger les autres sont pourtant toujours plus nombreuses. Une autre page de
ce site évoque encore plus en détail le christianisme dans le monde
d’aujourd’hui : cliquer ici.
Illustration extraite du livre
« Images
spirituelles contemporaines »
ENFIN, QUELQUES SITES DE RÉFÉRENCE :
Aujourd’hui, les rencontres et les relations
entre les différents courants religieux sont de plus en plus nombreuses, de
même que des efforts de textes et même de célébrations œcuméniques. Aussi je
mêle volontairement ci-dessous des liens provenant des différentes
tendances du christianisme et de leurs relations avec les religions
les plus proches :
Pensée
chrétienne
Liens vers de belles phrases et images inspirantes,
tout pour la méditation et la prière
Belles phrases de la Bible ou des saints classées
selon l’humeur ou le moment
Citations des plus grands noms de la spiritualité
chrétienne joliment illustrées
Les
principaux saints chrétiens
Vie et plus belles phrases des principaux saints
chrétiens
Les plus belles œuvres de l’art du passé, art chrétien
contemporain
Le christianisme dans la culture populaire
Les influences
religieuses dans Star Wars, Indiana Jones, le Da Vinci Code etc
Prophéties,
croyances et symboles chrétiens
Nombres dans la Bible, Chrisme, carré SATOR etc
Liens entre les grandes religions
Proximités du
christianisme avec le bouddhisme et l’islam
Retour au
sommaire : être chrétien c’est quoi ?
Nouveauté :
Un oracle spirituel
et astrologique en même temps, utilisable soit avec un livre seul, soit de
façon gratuite sur un site où les cartes s’animent ce qui est inédit, soit en
mêlant les deux méthodes. Cliquez ci-dessous : Auteure du
site : Marie Marin centuries@aol.com Tous droits réservés.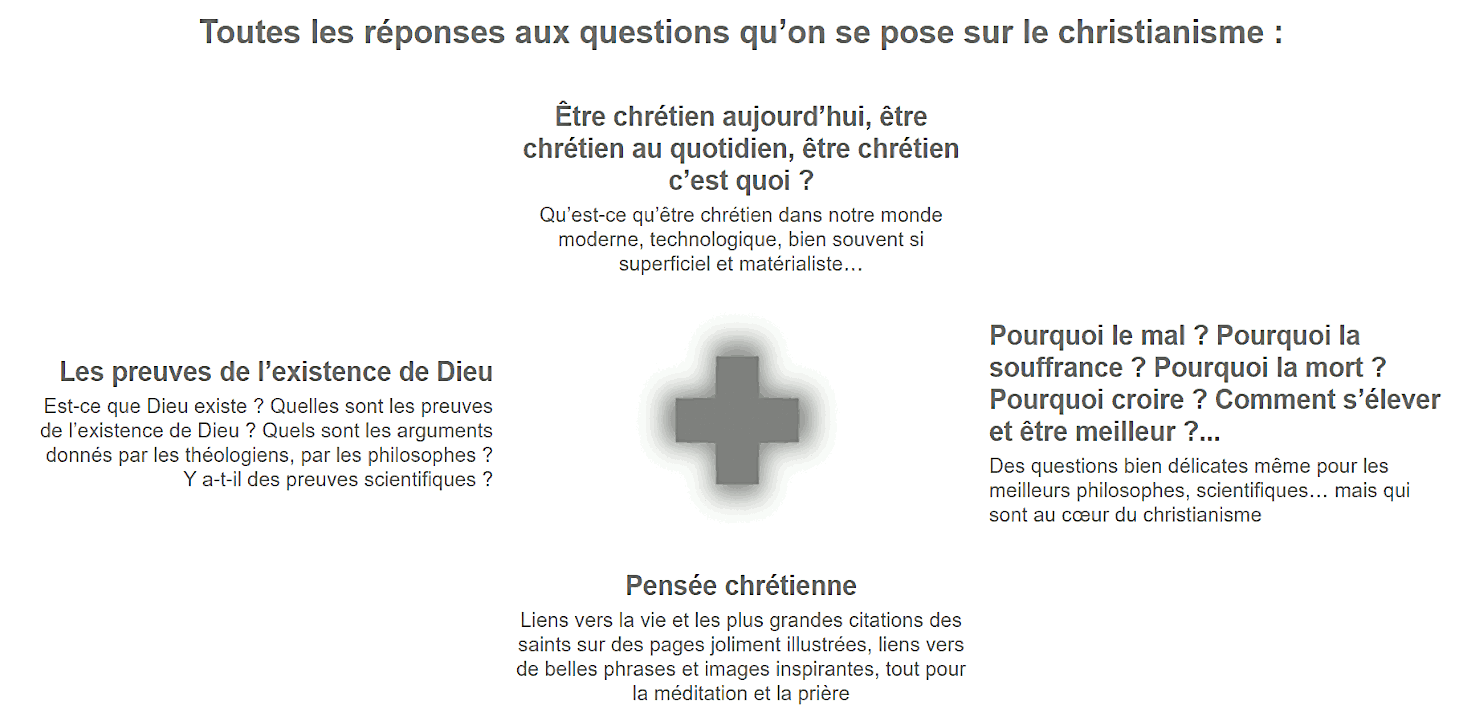
![]() Mentions
légales : lien
Mentions
légales : lien